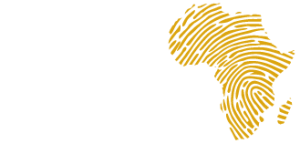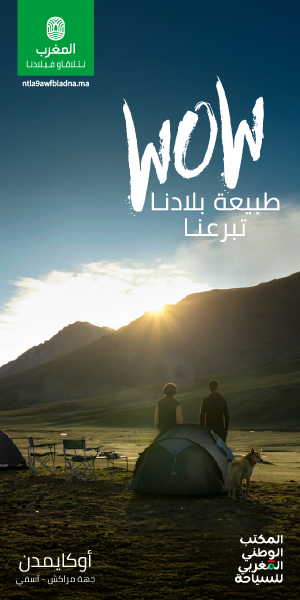Le 12 mai 2025, devant un parterre de journalistes réunis au siège de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf a dévoilé, pour la première fois depuis son entrée en fonction, les grandes lignes de sa feuille de route. Mais derrière les slogans d’intégration, de paix durable et d’indépendance financière, les embûches s’amoncellent déjà sur la trajectoire du président de la Commission, pris en étau entre les divisions des États membres et les limites structurelles d’une organisation encore largement dépendante de ses partenaires extérieurs.
D’entrée, le ton se veut lucide, presque désabusé : « Nous constatons avec regret que les décisions de notre architecture de paix et de sécurité restent trop souvent de l’encre sur du papier, et cela doit changer », a-t-il concédé. Une reconnaissance publique rare, à rebours du discours institutionnel convenu, qui place d’emblée la Commission face à ses échecs les plus criants. Car la mécanique de prévention des crises, articulée autour de la Force africaine en attente et du Système continental d’alerte précoce, reste en panne. Faute de volonté politique des États membres, mais aussi de financements pérennes, les instruments censés garantir une réponse rapide aux conflits — de l’est de la RDC au Soudan en passant par la Somalie et le Soudan du Sud — peinent à dépasser le stade de l’incantation.
Mahmoud Ali Youssouf le sait : sans réforme en profondeur, l’UA restera spectatrice des drames qui minent le continent. Le président de la Commission a ainsi annoncé une refonte de l’architecture institutionnelle de paix et de sécurité, en lien avec le Département des affaires politiques. Objectif affiché : replacer la prévention au centre du dispositif, avec une capacité d’anticipation permanente et crédible. Une gageure, tant les divergences entre États sur la définition même de « sécurité » – militaire, économique, climatique ou sociale – paralysent toute action concertée.
Lire aussi : Kenya: le secteur aérien génère 3,1 % du PIB, selon l’IATA
Les pièges de l’intégration économique
Autre priorité, et non des moindres : faire du rôle de l’Afrique dans le commerce mondial un levier stratégique. Le président de la Commission ambitionne de capitaliser sur l’entrée de l’UA dans le G20 pour peser davantage sur les grandes chaînes de valeur mondiales. Mais là encore, l’enthousiasme se heurte à la réalité des cloisonnements économiques entre pays africains, à la lente mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf), et à la fragmentation des politiques industrielles nationales.
Le risque est réel de voir le G20 devenir une simple tribune diplomatique de plus, sans capacité réelle d’influence sur les grands équilibres commerciaux mondiaux. D’autant que les initiatives africaines peinent encore à trouver une voix commune sur les grands dossiers du commerce, de la fiscalité internationale ou de la transition énergétique.
Peut-être plus stratégique encore, Mahmoud Ali Youssouf place l’autonomie financière de l’UA au cœur de son mandat. Un vœu pieux, alors que l’organisation reste largement sous perfusion extérieure : 600 millions d’euros d’aide européenne pour le seul maintien de la paix entre 2022 et 2024, et une dépendance chronique à des bailleurs qui conditionnent leur soutien à des exigences parfois contraires aux intérêts politiques des États africains.
Conscient de cette vulnérabilité, le président de la Commission appelle à « explorer des mécanismes innovants de financement », sans toutefois en préciser les contours. Or, les précédentes tentatives d’instaurer des taxes continentales sur les importations, les billets d’avion ou les transactions financières se sont toutes heurtées à la réticence des États, peu enclins à céder une part de leur souveraineté fiscale à l’organisation panafricaine.