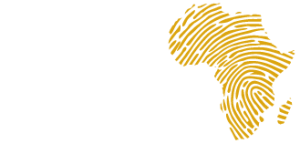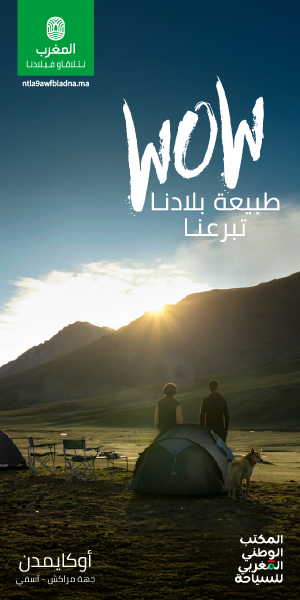C’est dans un climat politique déjà tendu, le Togo vient d’entériner un tournant institutionnel majeur qui bouleverse les équilibres républicains et suscite de vives inquiétudes, tant sur le plan interne qu’international. Avec la promulgation d’une nouvelle Constitution en mai 2024 instaurant un régime parlementaire, le président Faure Gnassingbé a opéré une transformation radicale du système politique togolais, qui renforce considérablement son emprise sur l’appareil d’État. En se plaçant à la tête du Conseil des ministres – nouvelle instance exécutive suprême – tout en marginalisant le rôle du président de la République réduit à une fonction honorifique, le chef de l’État semble avoir réussi un passage en force qui redéfinit les règles du jeu… sans les quitter.
Cette reconfiguration institutionnelle, préparée de longue date par un pouvoir coutumier des révisions constitutionnelles à géométrie variable, intervient dans la foulée d’une victoire sans appel du parti présidentiel, l’Union pour la République (UNIR), aux élections législatives d’avril 2024. Fort d’une majorité écrasante, Faure Gnassingbé a consolidé sa mainmise sur les leviers de l’État, désamorçant tout contre-pouvoir parlementaire. Les opposants dénoncent ce qu’ils qualifient de « coup d’État constitutionnel », dénonçant une dérive autoritaire maquillée sous des atours juridiques.
Mais la manœuvre ne se limite pas à un simple glissement institutionnel. Elle intervient dans un contexte régional marqué par des recompositions politiques brutales – du Mali au Tchad en passant par le Burkina Faso – et dans un climat sécuritaire de plus en plus volatile. Le nord du pays, frontalier avec le Burkina Faso, a été endeuillé en juillet 2024 par une attaque djihadiste meurtrière, révélatrice de la fragilité des marges territoriales face à l’expansion des groupes armés sahéliens. La menace sécuritaire, bien réelle, pourrait servir de prétexte à un renforcement accru de l’appareil répressif, au détriment des libertés civiles.
Lire aussi : Trafic de véhicules : Interpol remonte les filières d’un crime mondialisé jusqu’en Afrique de l’Ouest
À l’intérieur du pays, la société civile s’inquiète de la fermeture progressive des espaces d’expression démocratique. Les tentatives d’organiser des mobilisations populaires ont été systématiquement étouffées, les médias critiques mis au pas, et plusieurs figures de l’opposition contraintes à l’exil ou réduites au silence. Une chape de plomb s’abat lentement sur le Togo, dont l’histoire récente porte encore les stigmates d’un pouvoir dynastique prolongé depuis plus d’un demi-siècle.
Face à cette accumulation de signaux d’alerte, la communauté internationale reste prudente, oscillant entre préoccupations sur la gouvernance et préservation d’un partenaire stable dans une région en proie à des convulsions répétées. Les appels à un « dialogue national inclusif » se heurtent à une sourde oreille à Lomé, où le pouvoir campe sur sa légitimité électorale.
Le virage institutionnel orchestré par Faure Gnassingbé, loin de garantir la stabilité annoncée, pourrait à moyen terme précipiter le Togo dans une zone de turbulences. En verrouillant l’appareil d’État, le président togolais prend le risque de provoquer une implosion du fragile consensus national, au moment même où le pays aurait besoin d’un pacte de confiance pour affronter ses défis sécuritaires et économiques. Sous les dehors policés du parlementarisme, c’est une concentration de pouvoir sans précédent qui se dessine, porteuse de tensions sociales, de dérives autoritaires et de potentielle déstabilisation.