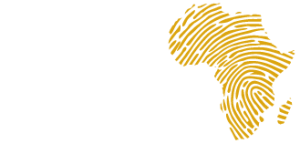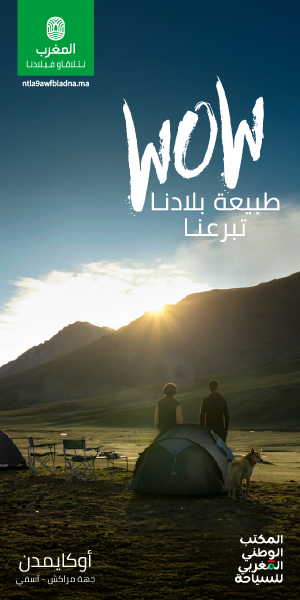Alors que le Sahel s’enfonce dans un cycle de violences meurtrières, les regards se tournent désormais vers Alger, soupçonné de jouer un rôle trouble derrière l’instabilité persistante qui ensanglante les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). Depuis plusieurs années, malgré les efforts des autorités militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou pour éradiquer les groupes armés terroristes, la région reste confrontée à une résurgence dramatique des attaques, alimentant le spectre d’une déstabilisation généralisée.
Derrière son imposant dispositif militaire déployé au sud de son territoire, l’Algérie est désormais accusée par plusieurs sources sécuritaires maliennes et nigériennes, mais également par des analystes étrangers basés à Bamako et Niamey, de soutenir en sous-main les réseaux terroristes. Selon ces témoignages concordants, une part importante des armes, des munitions et des équipements saisis récemment auprès des combattants islamistes proviendrait directement des stocks militaires algériens ou de filières clandestines contrôlées par Alger.
La situation sur le terrain illustre la gravité de ces soupçons. Dans le nord du Mali, les forces armées ont mené une opération offensive d’envergure dans le secteur de Kochia, parvenant à neutraliser trois chefs notoires de Groupes armés terroristes (GAT). Parmi eux figuraient Samba Diallo, tristement célèbre pour sa maîtrise des mines artisanales, ainsi qu’Amadou Barry, dit « Bourra », et Ibrahima Diallo. Lors de cette opération, les soldats maliens ont découvert un arsenal militaire sophistiqué, des stocks importants de munitions et du matériel de fabrication d’engins explosifs improvisés, révélant l’ampleur de la logistique sur laquelle s’appuient les réseaux djihadistes.
Lire aussi : Blanchiment de 190 millions d’euros: le fils de Macky Sall convoqué…
Au Niger, dans la région de Tillabéri, les forces de l’opération antiterroriste Almahaou ont payé un lourd tribut. Douze soldats nigériens ont été tués lors d’une embuscade sanglante, soigneusement planifiée par des terroristes opérant sous couverture de campements civils, une technique de plus en plus utilisée pour contourner les dispositifs de surveillance.
Depuis plusieurs mois, Alger a discrètement renforcé son dispositif militaire dans les régions méridionales du pays, invoquant officiellement la nécessité de « protéger ses frontières ». Toutefois, ce redéploiement coïncide étrangement avec une recrudescence des activités terroristes dans les zones les plus stratégiques du Sahel, en particulier dans la région dite des « trois frontières », au carrefour du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette zone, riche en ressources naturelles et en minerais stratégiques, est devenue un enjeu géopolitique majeur.
Des officiers maliens et nigériens, s’exprimant sous couvert d’anonymat, dénoncent ouvertement un double-jeu orchestré par le chef d’état-major algérien Saïd Chengriha et le président Abdelmadjid Tebboune. Selon eux, Alger utiliserait certains groupes armés comme des instruments pour maintenir une instabilité chronique, limiter l’expansion de puissances rivales dans la région et préserver ses propres intérêts économiques, notamment ceux liés aux trafics transfrontaliers de grande ampleur.
Dans un contexte où les pays de l’AES peinent à reprendre durablement le contrôle de leurs territoires et où les civils continuent de payer un prix exorbitant, la stratégie algérienne apparaît de plus en plus périlleuse. En parrainant une instabilité contrôlée, Alger prend le risque de provoquer une déflagration régionale incontrôlable, menaçant de faire sombrer l’ensemble du Sahel dans un chaos sans précédent.
Face à l’intensification des violences et à la multiplication des attaques terroristes, les États de l’AES se retrouvent aujourd’hui au pied du mur. Leur lutte pour la souveraineté et la stabilité, déjà ardue, se complique davantage dans un environnement où les alliances occultes et les manipulations régionales semblent primer sur la recherche d’une véritable paix durable.