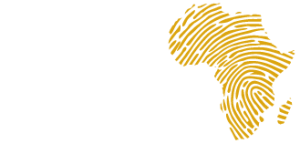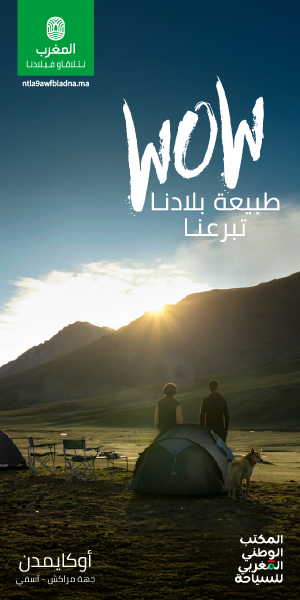Par un geste diplomatique fort, l’Équateur entérine la fin de sa reconnaissance de la prétendue RASD et amorce une nouvelle ère de coopération stratégique avec le Maroc. Ce réalignement, symptomatique d’un isolement croissant du Polisario, sonne comme un désaveu cinglant pour l’Algérie, son principal soutien.
C’est une page qui se tourne discrètement mais résolument dans les relations internationales. Le 15 mai, la ministre équatorienne des Affaires étrangères, Gabriela Sommerfeld, a annoncé l’ouverture imminente d’une ambassade de son pays à Rabat, prévue pour la fin juin. Derrière cet acte diplomatique se cache un basculement de fond : le retrait de la reconnaissance de la pseudo-« République arabe sahraouie démocratique » (RASD), qui actait depuis plus de quatre décennies l’alignement de Quito sur les thèses séparatistes portées par le Polisario et soutenues activement par Alger.
L’Équateur rejoint ainsi le nombre croissant de pays sud-américains qui, au fil des mois, tournent le dos à une fiction diplomatique née de la guerre froide et qui ne survit plus aujourd’hui que sous perfusion idéologique algérienne. Après le Pérou, le Paraguay, et d’autres partenaires traditionnels du Maroc dans la région, c’est au tour de Quito de marquer sa préférence pour une solution réaliste, pragmatique et conforme aux principes de souveraineté : le plan d’autonomie proposé par le Royaume du Maroc.
Lire aussi : Égypte : Le CAD renforce les synergies économiques africaines lors de sa 41ème mission multisectorielle
La nomination prochaine d’un ambassadeur d’Équateur au Maroc, prévue pour coïncider avec l’investiture du président Daniel Noboa le 24 mai, viendra sceller cette réorientation géopolitique. Ce nouveau partenariat repose autant sur des intérêts économiques que sur une convergence politique croissante, dans un monde multipolaire où les postures figées du XXe siècle perdent de leur pertinence.
Un camouflet pour Alger
La rupture avec le Polisario n’a pas été sans conséquences. Dès janvier 2024, en représailles à la décision équatorienne, le régime algérien a brutalement suspendu ses importations de bananes équatoriennes, privant ainsi son marché de son principal fournisseur. Le choc n’a pas tardé : en pleine période de Ramadan, les prix du kilo de bananes ont explosé, atteignant jusqu’à 850 dinars, alimentant un mécontentement populaire déjà latent. Ce geste illustre à quel point l’Algérie reste enfermée dans une logique de confrontation stérile, incapable d’admettre l’effritement de son influence autour de la cause sahraouie.
Mais au-delà du cas équatorien, c’est l’ensemble du dispositif diplomatique construit par Alger autour du Polisario qui montre des signes d’épuisement. La multiplication des retraits de reconnaissance de la RASD sur le continent sud-américain envoie un signal clair : la communauté internationale, y compris dans ses segments autrefois acquis à la cause du Front, semble désormais privilégier la stabilité, le développement et le réalisme politique.
Le recul diplomatique du Polisario traduit l’obsolescence croissante d’un instrument que l’Algérie avait longtemps utilisé pour contenir l’influence régionale du Maroc. En perdant l’un après l’autre ses soutiens historiques, ce mouvement séparatiste, sans assise populaire réelle et déconnecté des dynamiques régionales actuelles, se dirige vers une marginalisation définitive sur la scène internationale. Sa prétendue représentativité ne convainc plus ; son discours figé dans les slogans de la guerre froide ne mobilise plus.
Dans ce contexte, le choix de l’Équateur prend une valeur symbolique et stratégique. Il témoigne d’un réalignement progressif mais profond de l’Amérique latine, où le Maroc gagne du terrain grâce à une diplomatie d’influence fondée sur la coopération économique, la formation, et la stabilité politique. En face, le Polisario, relégué au rôle de simple satellite de la diplomatie algérienne, voit se refermer un à un les chapitres d’un récit international qui ne trouve plus d’audience.
L’ouverture d’une ambassade équatorienne à Rabat, accompagnée de la fermeture du bureau de la RASD à Quito, cristallise un changement de paradigme. Ce mouvement, désormais irréversible, conforte la légitimité du plan marocain d’autonomie comme seule solution sérieuse et crédible au différend régional autour du Sahara. Il illustre également l’isolement croissant d’un front séparatiste de plus en plus perçu comme une anomalie diplomatique, maintenue à flot uniquement par la rente gazière algérienne.