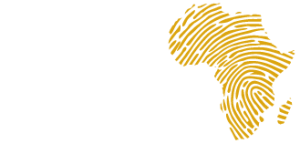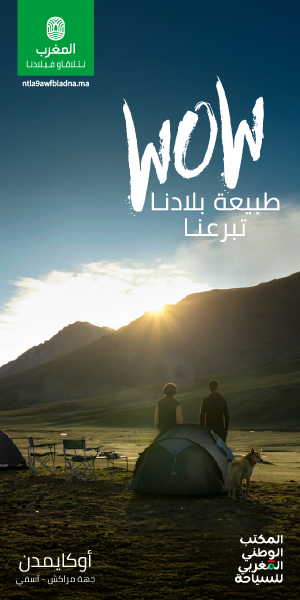Malgré un environnement mondial sous tension, l’Afrique subsaharienne continue de surprendre par la solidité de sa reprise. La Banque mondiale anticipe une croissance de 3,8 % en 2025, puis une accélération à 4,4 % sur la période 2026-2027. Porté par la baisse de l’inflation et l’essor des investissements, le continent confirme sa capacité d’adaptation.
L’économie africaine démontre une remarquable endurance face à un contexte international marqué par l’incertitude géopolitique et la volatilité des marchés. Selon le rapport « Africa’s Pulse » de la Banque mondiale, l’activité régionale, après un creux en 2023, amorce une reprise solide : +3,5 % en 2024, +3,8 % en 2025, avant de se stabiliser autour de 4,4 % sur la période 2026-2027.
Ce rebond traduit à la fois une meilleure gestion macroéconomique et une capacité accrue à absorber les chocs externes. Plusieurs facteurs concourent à cette embellie : la détente progressive des prix, le retour à la stabilité des monnaies locales dans de nombreux pays, et la reprise de la demande intérieure soutenue par l’investissement privé et public.
Dans un environnement mondial où les grandes puissances révisent leurs stratégies économiques, l’Afrique s’affirme comme un pôle de stabilité relative, et un espace où les réformes structurelles commencent à produire leurs effets.
Des déséquilibres persistants, mais une confiance retrouvée
Malgré cette dynamique, le continent reste confronté à des vulnérabilités structurelles. La consolidation budgétaire, imposée par les tensions sur les finances publiques, pèse sur les marges de manœuvre de plusieurs États. À cela s’ajoutent les risques commerciaux liés aux nouvelles barrières tarifaires américaines, susceptibles d’affecter certaines économies exportatrices.
Cependant, la tendance de fond demeure positive : la croissance africaine est aujourd’hui plus diversifiée, moins dépendante des seules matières premières. D’après les projections de la Banque mondiale, neuf pays devraient maintenir, entre 2025 et 2027, des taux de croissance supérieurs à 6 %. Cette performance s’appuie sur un socle commun : réformes économiques, investissements massifs dans les infrastructures et montée en puissance des secteurs productifs.
Symbole de cette nouvelle ère, la Guinée est en passe de devenir l’un des champions économiques du continent. Tirée par la mise en exploitation du gigantesque gisement de fer de Simandou, son PIB devrait croître de 7,5 % en 2025 à plus de 11 % en 2027.
Attendu depuis plus de trente ans, ce projet monumental, fruit d’un partenariat entre Rio Tinto, Chinalco, Baowu et Hongqiao, mobilise plus de 21 milliards de dollars d’investissements. Il comprend la construction d’un chemin de fer de 600 kilomètres et d’un port en eaux profondes à Morebaya, ouvrant la voie à une intégration économique sans précédent.
Les retombées s’annoncent considérables : la Guinée deviendrait le premier producteur africain de minerai de fer et le septième au monde, tandis que le FMI estime à 26 % la hausse potentielle du PIB d’ici 2030. Le projet Simandou illustre à lui seul la mutation du modèle africain : la valeur ne repose plus uniquement sur l’exportation brute, mais sur la création de chaînes industrielles et logistiques à forte intensité d’emploi.
Avec près de 130 millions d’habitants, l’Éthiopie confirme sa position de locomotive régionale. Sa croissance, projetée à 7,2 % en 2025 et 7,7 % en 2027, repose sur la montée en puissance du secteur industriel, le dynamisme agricole et la transformation énergétique du pays.
L’entrée en service du Grand Barrage de la Renaissance, le plus important du continent, constitue un atout stratégique : il améliore la sécurité énergétique nationale et place l’Éthiopie au cœur d’un marché régional de l’électricité à fort potentiel d’exportation.
Le modèle éthiopien illustre un choix assumé : privilégier la production et la transformation locale plutôt que la dépendance à l’importation, tout en maintenant un équilibre entre croissance économique et inclusion sociale.
Lire aussi : Afrique : le coton, levier de croissance et d’innovation durable
Rwanda, Bénin et Côte d’Ivoire : les nouveaux laboratoires du développement africain
Le Rwanda poursuit son ascension discrète mais constante. Sa stratégie de diversification et de numérisation de l’économie a permis de faire du pays un pôle de services compétitif, où le tourisme, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’industrie contribuent à hauteur de 51 % du PIB. Entre 2025 et 2027, la croissance devrait se maintenir au-dessus de 7 %. L’enclavement géographique et la dépendance logistique vis-à-vis de ses voisins restent des défis, mais le pays mise sur l’innovation et la planification rigoureuse pour y répondre.
Le Bénin, de son côté, confirme sa stabilité économique avec des taux avoisinant 7 % sur trois années consécutives. Les réformes portuaires et fiscales, associées à une inflation maîtrisée (environ 2 %), renforcent l’attractivité du pays auprès des investisseurs.
Quant à la Côte d’Ivoire, elle poursuit son rôle de moteur de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), avec une croissance prévue de 6,5 % en 2027, soutenue par les infrastructures, l’énergie et les industries de transformation agricole.
Des économies en mutation : énergie, mines et logistique
Au-delà des champions traditionnels, de nouveaux pôles de croissance émergent. L’Ouganda et le Niger misent sur les hydrocarbures pour doper leurs recettes et renforcer leur autonomie budgétaire. La Tanzanie, forte de ses ressources minières et de ses projets logistiques, aspire à devenir un hub régional.
Ces économies traduisent une tendance de fond : la réindustrialisation africaine s’appuie désormais sur des infrastructures intégrées — ports, chemins de fer, pipelines — visant à connecter les marchés intérieurs aux échanges mondiaux.
Les perspectives africaines sont indéniablement porteuses d’espoir, mais elles demeurent fragiles. Le poids de la dette, les effets du changement climatique et la dépendance à l’égard des marchés extérieurs constituent autant de facteurs de vulnérabilité. Pour transformer la croissance en développement durable, les États devront consolider leurs cadres de gouvernance, investir dans le capital humain et renforcer l’intégration régionale.
L’Afrique subsaharienne se trouve aujourd’hui à un tournant historique : celui où la croissance ne suffit plus, et où la transformation structurelle devient une nécessité stratégique. Sous l’effet conjugué de la dynamique démographique, de l’innovation et des partenariats stratégiques, le continent pourrait s’imposer, à l’horizon 2030, comme l’un des nouveaux pôles d’équilibre économique mondial.