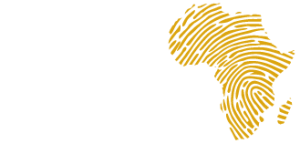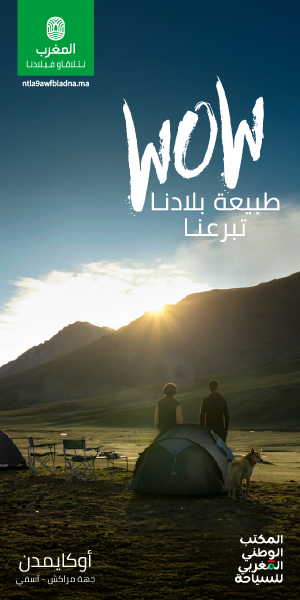En marge de l’ouverture de la Global Growth Conference 2025, l’ancienne premier ministre du Sénégal et haut représentant du président du Sénégal, Aminata Touré, a livré une intervention résolument tournée vers l’avenir. S’exprimant dans le cadre de la session « Financer la croissance et façonner la transition énergétique : stimuler l’investissement, renforcer l’attractivité et garantir la stabilité. », Aminata Touré a lancé un appel sans détour à une refondation profonde de l’économie africaine. Non pas une réforme superficielle, mais une remise en question des fondements mêmes qui structurent encore aujourd’hui les politiques économiques du continent.
« Nous sommes toujours restés dans le paradigme d’Adam Smith », regrette Aminata Touré. Selon elle, l’Afrique n’a pas encore produit sa propre école de pensée économique, adaptée à ses réalités sociales, historiques et structurelles. Une critique frontale des modèles importés, forgés dans des contextes post-industriels du XIXe siècle, et plaqués sur des sociétés où l’économie informelle reste la norme. « Au Nigeria, 80 % de l’économie ne figure même pas dans les comptes nationaux. Comment peut-on parler de croissance en ignorant l’essentiel de la création de valeur ? », interroge-t-elle.
Pour Aminata Touré, l’économie informelle n’est pas un résidu archaïque, mais un pilier de la vie économique réelle. Les microentreprises non enregistrées, les circuits locaux d’approvisionnement, la microfinance communautaire : ce sont eux qui nourrissent les populations. Or, ces acteurs sont absents des politiques publiques, exclus du financement, négligés dans les stratégies de croissance. « Ce sont ces femmes et ces hommes qui mettent du pain sur la table. Ou plutôt du couscous, puisque nous sommes au Maroc », lance-t-elle avec un sourire. Il est temps, selon elle, de placer cette économie « invisible » au cœur des préoccupations des chercheurs, des gouvernements et des institutions financières.
L’ancienne cheffe du gouvernement sénégalais n’élude pas les défis structurels : la dépendance vis-à-vis des importations de biens de consommation courante, comme les cure-dents ou les brosses à dents, illustre à ses yeux une faillite de la logique industrielle. « Il n’y aura pas de croissance endogène sans industrialisation », affirme-t-elle. Ce chantier est d’autant plus vital qu’il conditionne aussi l’avenir de l’agriculture, secteur qu’elle juge indispensable à moderniser urgemment. À ses yeux, l’enjeu est double : créer de l’emploi dans un contexte démographique sous tension, et sécuriser l’alimentation des populations face à la volatilité des marchés mondiaux.
Lire aussi : Global Growth Conference 2025 : Ce qu’il faut retenir de la session d’ouverture
Pour Aminata Touré, le potentiel africain ne pourra se déployer qu’à condition de revoir profondément les systèmes éducatifs. « Nous avons hérité d’un modèle d’éducation conçu au moment des indépendances. Soixante-cinq ans plus tard, il n’a pas été repensé », déplore-t-elle. Au Sénégal, 80 % des bacheliers sont issus de filières non scientifiques. Ce déséquilibre entrave l’émergence d’un tissu industriel et technologique compétitif. Face à la montée de l’intelligence artificielle, elle alerte : « En Afrique, où nous avons besoin d’emplois physiques, il faut positionner l’IA avec intelligence pour ne pas accélérer le chômage ».
Aminata Touré plaide également pour un changement d’échelle dans la conception des politiques de développement. Contre les logiques centralisées héritées du système colonial, elle prône une approche par le bas : « Ce sont les conseils de quartier, les conseils de village qui doivent devenir les moteurs de la croissance ». Pour elle, la relance économique passera par les initiatives communautaires, adossées à des mécanismes de financement adaptés. La microfinance, aujourd’hui reléguée aux marges, doit être réhabilitée et modernisée.
La question monétaire n’échappe pas à son analyse. La nécessité d’une monnaie ouest-africaine, récurrente dans les débats, prend ici un ton plus urgent. « Le franc CFA, ce n’est pas une monnaie souveraine. C’est une location », tranche-t-elle. Pour elle, seule une devise régionale offrirait la flexibilité budgétaire indispensable pour investir dans les secteurs clés. Mais elle tempère : « La monnaie n’est qu’un instrument. Il faut la lier à une stratégie industrielle et agricole cohérente ».
La dette extérieure n’est pas une fatalité, à condition de savoir mobiliser les ressources internes. Aminata Touré cite l’exemple du Sénégal, qui s’oriente désormais vers le marché régional pour financer son développement. Mais pour généraliser cette dynamique, il faudra formaliser l’épargne populaire, intégrer l’informel et concevoir des outils financiers adaptés à l’environnement africain. « Chaque ruisseau compte. Il faut le transformer en un grand fleuve capable de financer notre propre croissance ».
Sur la question énergétique, Aminata Touré tient une position nuancée mais ferme. Oui, l’Afrique doit s’engager dans la transition verte. Mais non, il n’est pas réaliste de demander aux pays qui découvrent du gaz ou du pétrole de ne pas les exploiter. « Si la communauté internationale veut être crédible, elle doit accepter un usage transitoire de ces ressources pour accompagner le rattrapage économique ». L’énergie solaire, l’éolien ou le nucléaire sont des voies d’avenir, mais elles nécessitent des transferts de technologie que les pays africains ne maîtrisent pas encore.
Enfin, Aminata Touré pose sans détour la question qui fâche : la corruption. « Au Sénégal, 4 000 milliards de francs CFA se sont évaporés. Comment parler de croissance partagée si cet argent disparaît dans les comptes ? », s’insurge-t-elle. Pour elle, aucune politique de développement ne peut réussir sans une lutte résolue contre ce fléau. Traquer les corrompus, récupérer les fonds détournés, restaurer la confiance : autant de prérequis pour bâtir une économie durable.