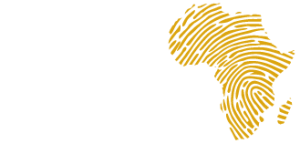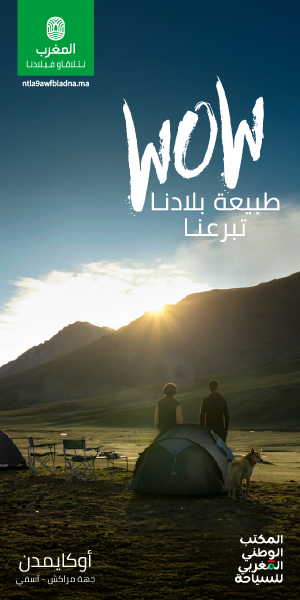Malgré une légère amélioration de son classement dans l’édition 2025 du rapport de Reporters sans frontières (RSF), l’Algérie demeure l’un des pays les plus hostiles à la liberté de la presse en Afrique du Nord. Derrière les chiffres, le paysage médiatique algérien est marqué par un climat de répression, de censure et de peur, sur fond d’instrumentalisation politique et de cadre législatif répressif.
Passée de la 139e à la 126e place sur 180 pays, avec un score de 44,64 contre 41,98 en 2024, l’Algérie enregistre une progression qui reste avant tout statistique. Cette légère remontée masque mal la dégradation structurelle des libertés journalistiques. La presse indépendante est en voie d’asphyxie : les journalistes sont régulièrement poursuivis ou emprisonnés, les sites critiques bloqués sans décision judiciaire, et les chaînes de télévision les plus influentes – Ennahar TV, Echorouk TV ou El Bilad TV – demeurent étroitement alignées sur les orientations du régime. Dans ce contexte, les rares titres encore perçus comme crédibles – El Watan, TSA ou Interlignes – opèrent sous constante pression, en équilibre instable entre autocensure et menaces judiciaires.
Depuis l’arrivée au pouvoir d’Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, l’architecture du pouvoir s’est renforcée autour d’un exécutif hypercentralisé, réduisant à néant les marges de manœuvre des médias. La présidence, les services de sécurité, les partis proches du régime et les autorités locales exercent un contrôle multiforme sur les rédactions. La mainmise sur la nomination des directeurs de publication et des responsables des autorités de régulation en témoigne. Dans ce système verrouillé, les journalistes sont les maillons faibles d’un appareil étatique obsédé par le contrôle de l’opinion.
L’encadrement légal de la presse, loin de garantir les droits fondamentaux, en constitue désormais l’un des principaux vecteurs de répression. L’article 54 de la Constitution, tout en proclamant la liberté de la presse, subordonne son exercice au respect des « constantes religieuses et culturelles de la nation ». Une ambiguïté dangereuse, aggravée par les réformes du Code pénal de 2020. La diffusion de « fausses nouvelles » ou de « discours haineux » est désormais passible de peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement – des formulations floues, taillées sur mesure pour étouffer toute voix dissonante. En 2023, un nouveau Code de l’information a encore durci la ligne : il interdit tout financement étranger aux médias algériens et introduit un régime de sanctions administratives et financières qui pèse lourdement sur les rédactions indépendantes.
La pression politique s’accompagne d’un étranglement économique. Depuis 2019, plusieurs chaînes privées ont fermé leurs portes, étranglées par l’absence de publicité – notamment celle issue des entreprises publiques, systématiquement réservée aux titres dociles. Dans ce paysage, la survie dépend souvent d’un alignement avec les discours officiels, vidant la presse de sa substance critique. Les subventions publiques ne profitent qu’aux médias étatiques ou proches du régime, renforçant une hiérarchisation politique de l’information.
Des fractures socioculturelles instrumentalisées
La liberté de ton varie selon les régions : dans les zones de l’intérieur et du sud, les autorités locales, les associations traditionnelles et les groupes religieux imposent une censure informelle redoutablement efficace. À cela s’ajoute un conservatisme social et religieux qui interdit l’exploration de certains sujets comme la sexualité, les droits des femmes ou la religion, réduisant ainsi les champs d’enquête à leur plus simple expression.
Sur le terrain, les conditions de travail des journalistes sont de plus en plus périlleuses. Aucun mécanisme de protection n’est en place face aux menaces, aux arrestations arbitraires et à la surveillance numérique systématique. Les reporters associés au Hirak – ce vaste mouvement populaire de contestation né en 2019 – sont particulièrement visés. Certains subissent des campagnes de harcèlement en ligne orchestrées par des comptes anonymes pro-régime, surnommés « mouches électroniques » ou doubab, qui participent à une stratégie plus large de dissuasion et de décrédibilisation.
En Algérie, la presse ne meurt pas dans l’indifférence : elle est méthodiquement démantelée, au nom de l’ordre public, de l’unité nationale ou de la stabilité du régime. Plus qu’un simple indicateur démocratique, la liberté de la presse constitue aujourd’hui le baromètre d’un autoritarisme qui avance masqué. Derrière les statistiques de RSF, ce sont des voix, des récits, et une pluralité de regards qui s’éteignent.