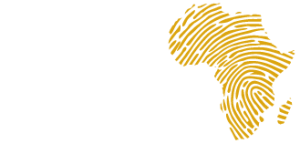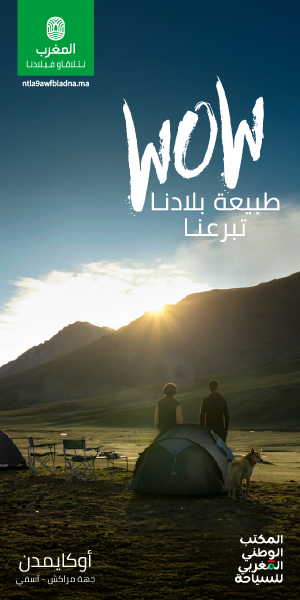La célébration, le 8 Mars, de la journée internationale des femmes offre l’opportunité de jeter la lumière sur la situation des femmes en Afrique australe, où les aspirations d’émancipation se heurtent souvent aux contraintes sociétales.
Dans la plupart des pays de la région australe, des stéréotypes néfastes sur le genre ont favorisé la montée de la violence à l’encontre des femmes et des filles. Le féminicide, qui reste une préoccupation majeure, est imputé aux structures, aux normes et aux pratiques sociales patriarcales marquées par une discrimination et une inégalité des sexes profondément enracinées.
D’autres problèmes dans la région contribuent à ce phénomène, notamment la grande pauvreté, les conflits et le manque de protection juridique pour les groupes les plus marginalisés, y compris les femmes et les filles.
En Afrique du Sud, première économie de la région, le féminicide prend une ampleur encore plus grave. Il est décrit comme la «deuxième pandémie» du pays où plus de 2.400 femmes sont assassinées chaque année, selon des statistiques de la dernière décennie, révélées par le Service de police. Des chiffres macabres confirmés par le Conseil sud-africain de recherche médicale, qui précise que chaque jour, sept femmes sont tuées en Afrique du Sud et que près de six meurtres sur dix sont commis par un mari.
Dans l’optique d’inverser cette tendance inquiétante, des experts estiment qu’il faut un changement culturel qui remette en question les attitudes et les stéréotypes enracinés sur l’égalité des sexes dans toutes les sphères de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), tout en dénonçant les normes sociétales qui perpétuent la violence sexiste et le féminicide.
Lire aussi : L’Afrique du Sud est vulnérable aux menaces sécuritaires (experts)
Dans une déclaration à la MAP, Ayanda Kunene, fondatrice et directrice de l’organisation Xumana Sibambane, a expliqué que le manque de volonté politique et les contraintes de ressources ralentissent souvent la mise en œuvre de solutions à ce problème sociétal. «En outre, il existe des barrières sociétales et culturelles, telles que la résistance au changement des normes de longue date concernant le genre et la violence, qui peuvent entraver le changement des politiques», relève-t-elle.
Idem pour le professeur Anni Hesselink, criminologue à l’Université de Limpopo, qui fait constater que le mépris des droits des femmes et des enfants et l’inégalité des femmes sont devenus la norme dans certaines cultures en Afrique australe. «Malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées dans la région jusqu’ici, les taux de féminicide demeurent élevés, particulièrement en Afrique du Sud», a-t-elle dit.
L’experte explique également que dans la plupart des cas, les auteurs de ces actes sont exposés dès l’enfance à la violence familiale brutale, aux abus physiques et émotionnels et à des modèles violents qui se transmettent ensuite de génération en génération, créant ainsi un cycle de violence.
Pour sa part, Lisa Vetten, chercheuse au Centre d’études sur les inégalités de l’Université Wits à Johannesburg, a déclaré que la véritable question était de savoir si le gouvernement sud-africains prendrait les mesures qui s’imposent, sur la base des recommandations de la première étude nationale sur la violence basée sur le genre. Les résultats de l’étude révèlent que 35,5 % des femmes sud-africaines (7,8 millions) ont été victimes de violences et qu’une femme sur trois âgée de 18 ans et plus a été victime de violences physiques et sexuelles au cours de sa vie.
L’étude recommande notamment l’adoption d’approches à long terme, culturellement pertinentes, axées sur la reconstruction des structures familiales et communautaires, l’engagement des dirigeants traditionnels, la promotion du changement sociétal et le renforcement de l’application des lois sur la violence basée sur le genre.
Désabusées par le manque d’efficacité des autorités face à ce fléau, certaines victimes de la violence basée sur le genre décident de s’organiser pour se défendre, allant même jusqu’à prendre les armes.