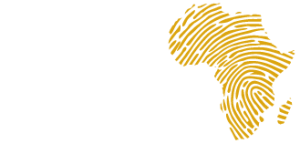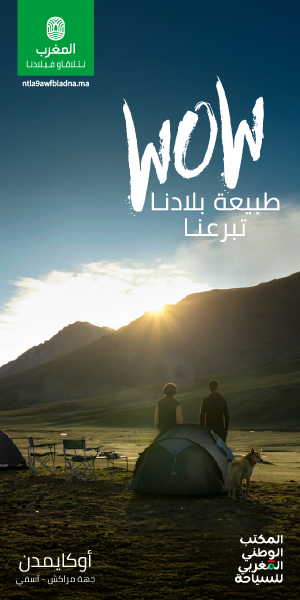L’administration consulaire ne serait qu’une façade. Derrière le traitement des passeports et des actes d’état civil, les services de renseignement d’Alger auraient tissé une toile d’influence et de surveillance destinée à museler la diaspora critique du régime. Une stratégie qui fait planer l’ombre d’une guerre d’espionnage entre Paris et Alger, sur fond de relations diplomatiques déjà fragilisées.
C’est une opération discrète mais redoutablement organisée que les services français disent observer depuis des années : le maillage consulaire de l’Algérie en France, l’un des plus denses au monde avec une vingtaine de représentations, ne serait pas uniquement dédié à servir les millions de binationaux et ressortissants algériens. Plusieurs sources sécuritaires françaises, citées dans une enquête fouillée du magazine L’Express, affirment que ces consulats abriteraient également des cellules de renseignement. Leur cible : les opposants politiques, les militants kabyles, les figures du Hirak et plus largement toutes les voix dissidentes qui s’expriment librement sur le sol français.
« Les services algériens n’ont jamais cessé d’opérer en France depuis l’indépendance. Ils ont des agents dans pratiquement tous les consulats », tranche Jérôme Poirot, ancien numéro deux du renseignement à l’Élysée. À Marseille, Lyon, Melun ou Rouen, des agents algériens camouflés sous statut diplomatique mèneraient des opérations d’observation, recruteraient des informateurs, infiltreraient les réseaux communautaires. Certains de ces agents seraient même d’anciens policiers français ou ex-officiers des renseignements généraux, recyclés en « agents de liaison ».
Ces accusations ne datent pas d’hier, mais elles ont pris une tournure plus sensible depuis l’émergence du Hirak en 2019. Le soulèvement populaire qui a ébranlé le régime algérien a poussé Alger à intensifier sa surveillance de la diaspora, perçue comme une caisse de résonance des contestations du régime à l’étranger.
Lire aussi : Algérie : l’État traque les derniers revenus des citoyens en taxant les activités en ligne
Le cas Ghilas Aïnouche
Ghilas Aïnouche en sait quelque chose. Ce dessinateur algérien, réfugié en France depuis 2020, affirme avoir été approché à plusieurs reprises par des émissaires liés au consulat d’Algérie. Les messages, déguisés en tentatives de dialogue, tournaient rapidement à la pression : « On m’a dit qu’on savait où je vivais. Ils voulaient que j’arrête de critiquer le régime dans mes dessins », raconte-t-il, encore sous le choc.
Selon lui, ces tentatives de manipulation visaient à le pousser à produire des œuvres plus conciliantes. Face à son refus, les pressions se sont transformées en menaces à peine voilées. « Leur objectif est clair : faire taire ceux qui dérangent. »
Au cœur de cette guerre de l’ombre, une figure cristallise les rancœurs algériennes : Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Loué par le passé pour sa capacité de dialogue, il est aujourd’hui perçu par le pouvoir algérien comme un adversaire. En janvier 2023, Abdelmadjid Tebboune l’a désigné publiquement comme « ennemi du peuple algérien ».
Depuis Paris, Driencourt continue d’agacer Alger par ses analyses critiques et ses réseaux d’influence. Dans son livre L’Énigme algérienne, il revendique une connaissance intime des rouages du régime. Ses rencontres régulières avec des opposants exilés, ses interventions dans les médias européens et ses échanges avec des diplomates nourrissent à Alger le soupçon d’une guerre d’influence souterraine orchestrée depuis Paris.
Silence diplomatique et guerre non déclarée
Cette tension se nourrit aussi de la paralysie des discussions bilatérales. En 2020, Driencourt aurait proposé une renégociation du traité migratoire de 1968, sans jamais obtenir de réponse. Pour Alger, cette initiative marquait une tentative de durcir les conditions d’entrée et de séjour des Algériens en France, une ligne rouge politique.
« Pour eux, il leur a déclaré la guerre », commente l’historien Benjamin Stora. Depuis, les relations se sont envenimées dans une guerre froide non dite, où les consulats servent de postes avancés de surveillance et d’influence.
Au-delà du cas Driencourt, c’est bien la stratégie d’Alger à l’égard de sa diaspora qui inquiète. « Le réseau consulaire agit comme une extension de l’appareil sécuritaire algérien sur le territoire français », explique un analyste. Une stratégie visant à maintenir une emprise idéologique, à dissuader toute contestation, et à étouffer les voix dissidentes loin des frontières.
Le cas de Ghilas Aïnouche, comme celui d’autres militants moins médiatisés, révèle l’existence d’un climat de peur savamment entretenu. « Ils disent que ce ne sont pas des menaces, mais c’en sont. Leur but est de faire taire les exilés comme moi », conclut le dessinateur.