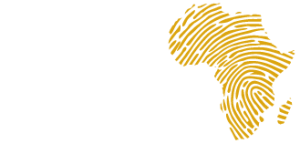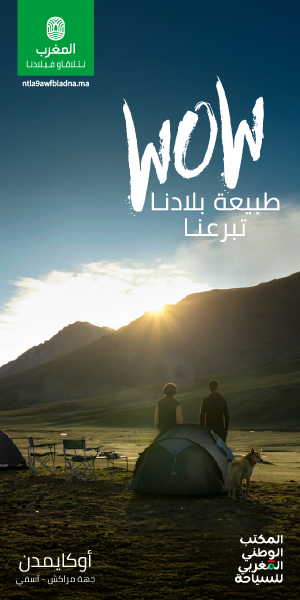Depuis 2019, l’Algérie traverse une période charnière marquée par l’aspiration populaire à un profond changement politique et économique. Le mouvement du Hirak, né de la contestation d’un système politique sclérosé et d’une économie trop dépendante des hydrocarbures, a porté les revendications citoyennes pour une gouvernance renouvelée et transparente. Cependant, face à ces attentes, les autorités ont répondu par des réformes superficielles et un renforcement du contrôle militaire, accentuant les tensions entre le désir de transformation sociopolitique et les résistances institutionnelles.
L’Algérie post-2019 se révèle être une période profondément contrastée de son histoire récente, incarnant un paradoxe criant entre les aspirations populaires exprimées lors du Hirak et les réalités politiques qui ont suivi ce mouvement. Abdessalam Jaldi, chercheur au Policy Center for the New South (PCNS), souligne dans son policy brief que l’Algérie traverse une phase complexe marquée par d’importants enjeux politiques, sociaux et économiques. En février 2019, une vague populaire d’une ampleur inédite balaya les rues algériennes en réponse à l’annonce controversée d’un cinquième mandat présidentiel pour Abdelaziz Bouteflika. Ce soulèvement pacifique, rapidement baptisé « Hirak », traduisait une exigence radicale de réformes politiques, économiques et institutionnelles. Les manifestants réclamaient notamment une rupture claire avec les pratiques héritées de la première République, dominée par une logique militaire, et appelaient explicitement à la fondation d’une « deuxième République » démocratique et transparente.
Toutefois, comme le souligne le chercheur du PCNS dans son analyse approfondie, la réponse du pouvoir à cette crise historique fut loin de correspondre aux attentes populaires. Bien que contraint de renoncer à la candidature de Bouteflika, l’establishment algérien, particulièrement l’Armée nationale populaire (ANP), a maintenu une mainmise quasi-absolue sur les leviers du pouvoir. Le départ précipité de Bouteflika ne s’est pas accompagné d’une véritable ouverture démocratique ; au contraire, il a ouvert une ère de consolidation du pouvoir militaire. La nomination d’Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, dans des circonstances largement critiquées et jugées peu transparentes par une grande partie de la population, n’a pas réussi à restaurer la confiance citoyenne.
Sous Tebboune, la présence militaire dans les affaires civiles s’est amplifiée, marquant une régression vis-à-vis des aspirations initiales du Hirak. Abdessalam Jaldi rappelle que malgré quelques réformes symboliques, telles que la révision constitutionnelle adoptée en 2020, le cœur du régime politique demeure inchangé. L’armée, à travers son chef d’état-major Saïd Chengriha, a renforcé sa domination, allant jusqu’à influencer ouvertement les décisions politiques clés. Cette militarisation croissante de la gouvernance est devenue particulièrement manifeste lors des élections, où les citoyens algériens, de plus en plus sceptiques quant à la sincérité du processus démocratique, ont manifesté une abstention record.
Simultanément, l’espace civique s’est drastiquement réduit. Abdessalam Jaldi décrit cette situation comme une érosion significative des libertés individuelles et publiques, notamment par la multiplication de lois répressives limitant les libertés de manifester, d’expression et d’association. La répression contre les voix dissidentes et critiques s’est intensifiée, visant journalistes, défenseurs des droits humains et acteurs associatifs. Des figures emblématiques du Hirak, comme les responsables de l’association RAJ ou encore le journaliste Ihsane El Kadi, ont subi arrestations et condamnations, témoignant d’un climat général de répression et d’étouffement de toute voix contestataire.
Sur le plan économique, les défis considérables auxquels fait face l’Algérie, notamment l’échec relatif à diversifier une économie encore très dépendante des hydrocarbures. Les réformes économiques annoncées par le président Tebboune tardent à voir le jour et les quelques initiatives industrielles, comme l’usine Fiat près d’Oran, restent insuffisantes pour inverser cette tendance lourde. L’économie algérienne demeure ainsi vulnérable aux fluctuations internationales, ce qui alimente l’insatisfaction populaire face à une inflation galopante et des inégalités persistantes.
En matière de politique étrangère, le chercheur note un retour au réalisme, mais aussi des incohérences et revers diplomatiques importants. Malgré les tentatives de se positionner comme un acteur incontournable sur la scène internationale, notamment à travers sa capacité énergétique, Alger peine à affirmer sa présence diplomatique, subissant plusieurs échecs notables, dont le refus de son adhésion au groupe des BRICS et une perte d’influence dans le Sahel.
Ainsi, loin des attentes profondes exprimées par le Hirak en 2019, l’Algérie contemporaine semble évoluer aux antipodes des revendications initiales du mouvement. Selon Abdessalam Jaldi, entre aspirations démocratiques bafouées, stagnation économique et recul des libertés, le pays se trouve à la croisée des chemins, face à un avenir incertain qui exigera des choix politiques courageux pour renouer avec l’esprit même du soulèvement populaire historique qui l’avait tant animé.