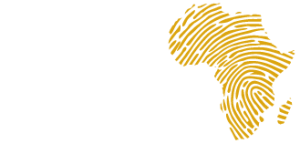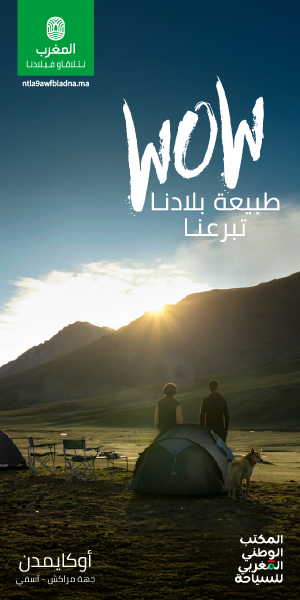Alors que l’espace budgétaire des États nord-africains se contracte sous l’effet conjugué d’un endettement croissant, d’un accès restreint aux financements internationaux et d’un ralentissement économique mondial, les envois de fonds de la diaspora apparaissent comme une source capitale de résilience économique. Long relégués au second plan dans les stratégies de développement, ces flux migratoires revêtent désormais une dimension stratégique, à la croisée des politiques monétaires, sociales et industrielles.
La dernière note d’orientation publiée par le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) met en lumière l’importance croissante des envois de fonds comme levier de financement extérieur dans la région. En 2023, ces flux ont atteint 38 milliards de dollars, représentant à eux seuls 70 % du total des financements extérieurs, loin devant l’aide publique au développement (17 %) et l’investissement direct étranger (13 %). Un basculement silencieux mais structurant.
Avec près de 25,6 millions de ressortissants établis hors du continent, l’Afrique du Nord est aujourd’hui la sous-région africaine qui enregistre le plus grand nombre d’émigrés. Ce chiffre, qui a plus que doublé en une décennie, témoigne à la fois de la pression sociale dans les pays d’origine et des opportunités saisies à l’étranger, notamment dans les pays du Golfe, en Europe ou en Amérique du Nord.
À elle seule, l’Égypte recense quelque 14 millions de ressortissants à l’étranger, suivie du Maroc (5 millions), de la Tunisie (1,5 million), de l’Algérie (2,1 millions), de la Libye et du Soudan (environ 2 millions chacun). Ces diasporas, historiquement structurées mais longtemps négligées dans les stratégies économiques, représentent aujourd’hui un relais vital pour les équilibres macroéconomiques.
Contrairement à d’autres flux de capitaux volatils, les envois de fonds ont démontré leur robustesse face aux crises successives. La pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques, ou encore les dérèglements climatiques n’ont que marginalement freiné ces flux. Au contraire, ils se sont consolidés comme une bouée de sauvetage pour des économies confrontées à la contraction du commerce, à la baisse des recettes touristiques et à la pression sur les monnaies locales.
Lire aussi : Blanchiment de 190 millions d’euros: le fils de Macky Sall convoqué par le parquet…
En 2023, le Maroc a reçu 11,8 milliards de dollars (+5,2 %), représentant 8,6 % de son PIB. L’Égypte, malgré une baisse conjoncturelle liée à la dualité des taux de change, reste en tête avec 19,5 milliards, soit 6,1 % de son PIB. La Tunisie (2,7 milliards de dollars) et l’Algérie (1,9 milliard) complètent le tableau, avec des montants moindres mais des usages essentiels : éducation, santé, logement, consommation courante.
Toutefois, une part importante de cette manne échappe aux circuits officiels, canalisée via des voies informelles motivées par les écarts de change ou la défiance envers les institutions bancaires locales. Cette réalité fragilise les efforts d’inclusion financière et prive les États de ressources potentiellement mobilisables pour l’investissement productif.
Vers une mobilisation plus stratégique de la diaspora
Le défi qui se pose désormais n’est plus tant celui de l’ampleur des flux, que celui de leur orientation. Comment transformer ces transferts à finalité principalement sociale en investissements structurants ? Comment capter une part de l’épargne de la diaspora – estimée à 53 milliards de dollars par an, dont 60 % proviennent d’Afrique du Nord – pour la réinjecter dans le tissu économique national ?
Certaines pistes émergent. L’émission d’obligations-diaspora, le développement de produits bancaires spécifiques, l’usage accru des plateformes numériques de transfert ou encore la libéralisation encadrée du taux de change figurent parmi les instruments testés ou envisagés. En Égypte, des réformes entamées en mars 2024 semblent déjà porter leurs fruits : les envois de fonds ont progressé de 42,6 % sur les neuf premiers mois de l’année, atteignant 20,8 milliards de dollars.
Au Maroc, Bank Al-Maghrib anticipe une augmentation continue pour atteindre 12 milliards de dollars en 2025. En Tunisie, où les transferts ont surpassé les recettes touristiques, leur poids dans les réserves en devises (122 jours d’importations) illustre leur caractère désormais vital.
Mais pour transformer l’élan en stratégie, une coordination régionale s’impose. La Commission économique pour l’Afrique, à travers son programme 2024-2028 « Renforcement du lien entre migration et développement », entend accompagner les États dans la structuration de politiques publiques plus inclusives. L’enjeu est double : sécuriser les flux existants et créer des cadres incitatifs à l’investissement pour la diaspora.
L’Afrique du Nord dispose d’un potentiel migratoire unique à l’échelle du continent. À condition d’être adossés à des réformes audacieuses, les envois de fonds peuvent devenir bien plus qu’une simple soupape sociale. Ils peuvent constituer un véritable vecteur de transformation économique.